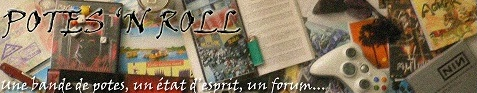Une loi contre la haine20/06/2019
Hier, le texte porté par la députée Laetitia Avia, « visant à lutter contre la haine sur Internet », était présenté à l’Assemblée. Le débat est ouvert…
Et dans Le Monde, une tribune cosignée par plusieurs ministres, dont Nicole Belloubet, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, défend ce projet de loi en évoquant quelques-unes de ses dispositions : « l’introduction de la plainte en ligne, la spécialisation d’un parquet rompu aux usages du numérique et la formation de ses juges aux problématiques spécifiques aux réseaux sociaux ». Les signataires soulignent que « seule la justice pourra effectivement permettre d’assurer l’équilibre entre liberté d’expression et sanction des abus de cette liberté, déjà prévue par la loi ». Et c’est là que le bât blesse… Car cette loi, c’est celle de 1881 sur la liberté de la presse, dont on envisage de sortir l’injure et la diffamation pour les inscrire dans le droit pénal commun.
La loi de 1881 sur la liberté de la presseComme le rappelle Jérôme Hourdeaux dans Mediapart, ce texte fondateur a mis en place un régime spécifique permettant de protéger la liberté d’expression, « avec des garanties procédurales, comme des délais de prescription plus courts ou encore l’interdiction de la détention provisoire. Le passage de ces infractions dans le code pénal permettrait, notamment, de faciliter les perquisitions ou encore les comparutions immédiates ». Me Christophe Bigot, avocat spécialisé en droit de la presse, rappelle que l’injure et la diffamation représentent 90 % du contentieux et que les exclure de la loi de 1881 reviendrait à la vider de sa substance. « Il y a déjà tout dans la loi », estime-t-il, et notamment « une disposition, à l’article 57, qui oblige normalement le juge à trancher dans un délai d’un mois. Mais elle ne peut pas être appliquée faute de moyens. » Le risque serait aussi de créer « une nouvelle bureaucratie de la censure », voire de « privatiser » le contrôle de la liberté d'expression, en imposant notamment aux plateformes la mise en place de dispositifs de censure automatique. Or les affaires d’injure et diffamation sont souvent complexes et méritent un traitement équilibré, difficilement compatible avec les algorithmes ou la comparution immédiate. Dans le FigaroVox, François Sureau estime que « si le but affiché par la proposition de loi est louable, elle risque de provoquer censure et autocensure sur tous les sujets de société qui font polémique ». L’écrivain et avocat doute que la haine puisse constituer une notion juridique.
Le législateur s’arroge désormais le droit de pénétrer dans les consciences, et que celles-ci soient mal inspirées ne change rien à l’affaire. Cette idée simple que penser n’est pas agir, que dire n’est pas faire, qu’avant l’acte criminel il n’y a rien, le cède par pans aux nécessités d’un contrôle social de plus en plus rigoureux. Sur la délégation de pouvoir du juge à des opérateurs privés pour assurer le contrôle des contenus haineux sur le web, François Sureau considère que « dès lors que la fonction de l’État n’est plus de mettre en œuvre le projet des libertés, mais simplement d’accompagner les sentiments des groupes opposés qui s’affrontent dans l’espace public, cette évolution est probablement inévitable. Dans le cas particulier de la proposition de loi, on voit bien comment son dispositif constitue un puissant encouragement à la censure, puisque les opérateurs privés préféreront, dans le doute, censurer plutôt que de voir leur responsabilité mise en cause. » Conclusion en deux temps : « Nous assistons au remplacement de la liberté par le culte des droits. »
Nous cherchons à recréer une forme de civilité par la répression. Il n’y a pas de civilité sans liberté.L'information en vase closÀ propos de la presse, Jérôme Lefilliâtre rend compte, dans les pages idées de Libération, d’une étude de l’Institut Montaigne, qui fait état d’un fonctionnement vertical du secteur, avec en haut, des journaux qui imposent l’agenda du débat public et en bas, des médias périphériques ou « alternatifs » aux idéologies aussi disparates que leur niveau de rigueur journalistique, et qui s’affirment en s’opposant aux premiers. Le résultat est une forme d’entre-soi au carré. Les grands médias se citent les uns les autres sans accorder plus d’intérêt aux petits, lesquels ne se construisent et n’existent que par la confrontation aux premiers. Mais, relève le journaliste, « en accordant si peu d’attention à ces satellites, donc aux revendications et thématiques politiques qu’ils tentent d’imposer, l’élite médiatique est susceptible de passer à côté de préoccupations pourtant bien réelles et d’alimenter au sein de la population un soupçon de déconnexion. »
À terme, le risque, avertit l’étude, est celui d’un détournement du public de ces médias, jugés trop institutionnels, et de leur fossilisationUn exemple récent l’illustre parfaitement. Les médias se sont intéressés tardivement et se sont trouvés débordés par le mouvement des gilets jaunes, ce qui n’a fait qu’accroître leur méfiance envers la presse. Ils se sont rabattus sur des médias comme RT France, le site russe financé par Moscou « qui a beaucoup progressé en audience depuis le début de la crise ».
Par Jacques Munier
 Topic: France Inter (Read 37127 times)
previous topic - next topic
Topic: France Inter (Read 37127 times)
previous topic - next topic